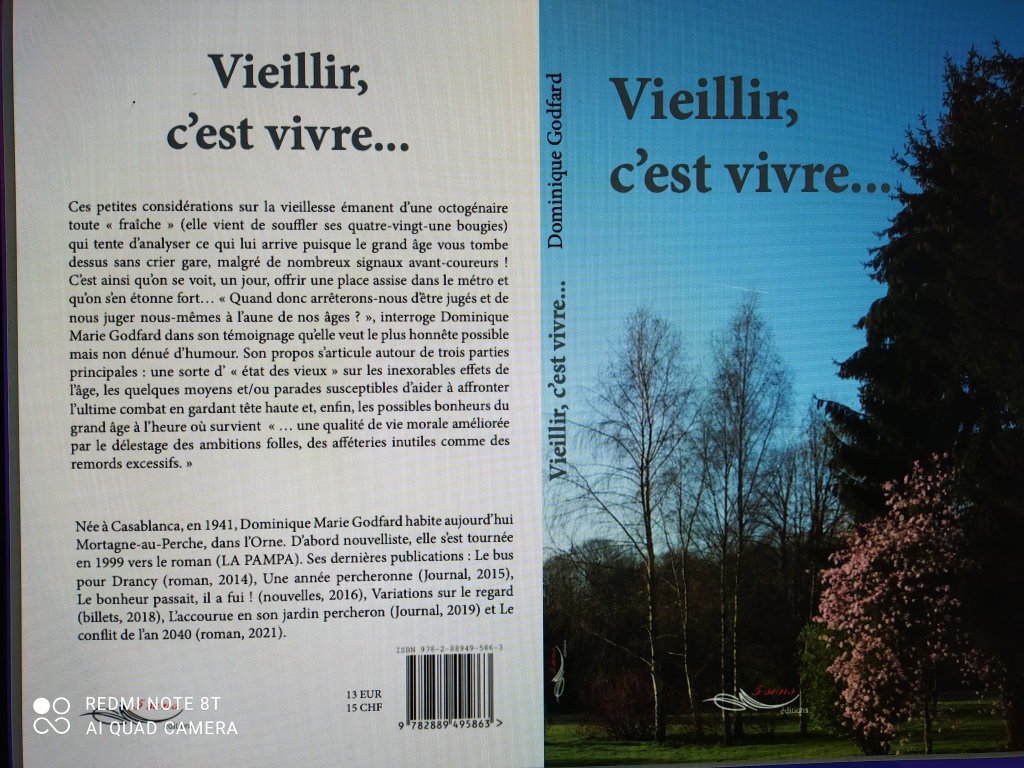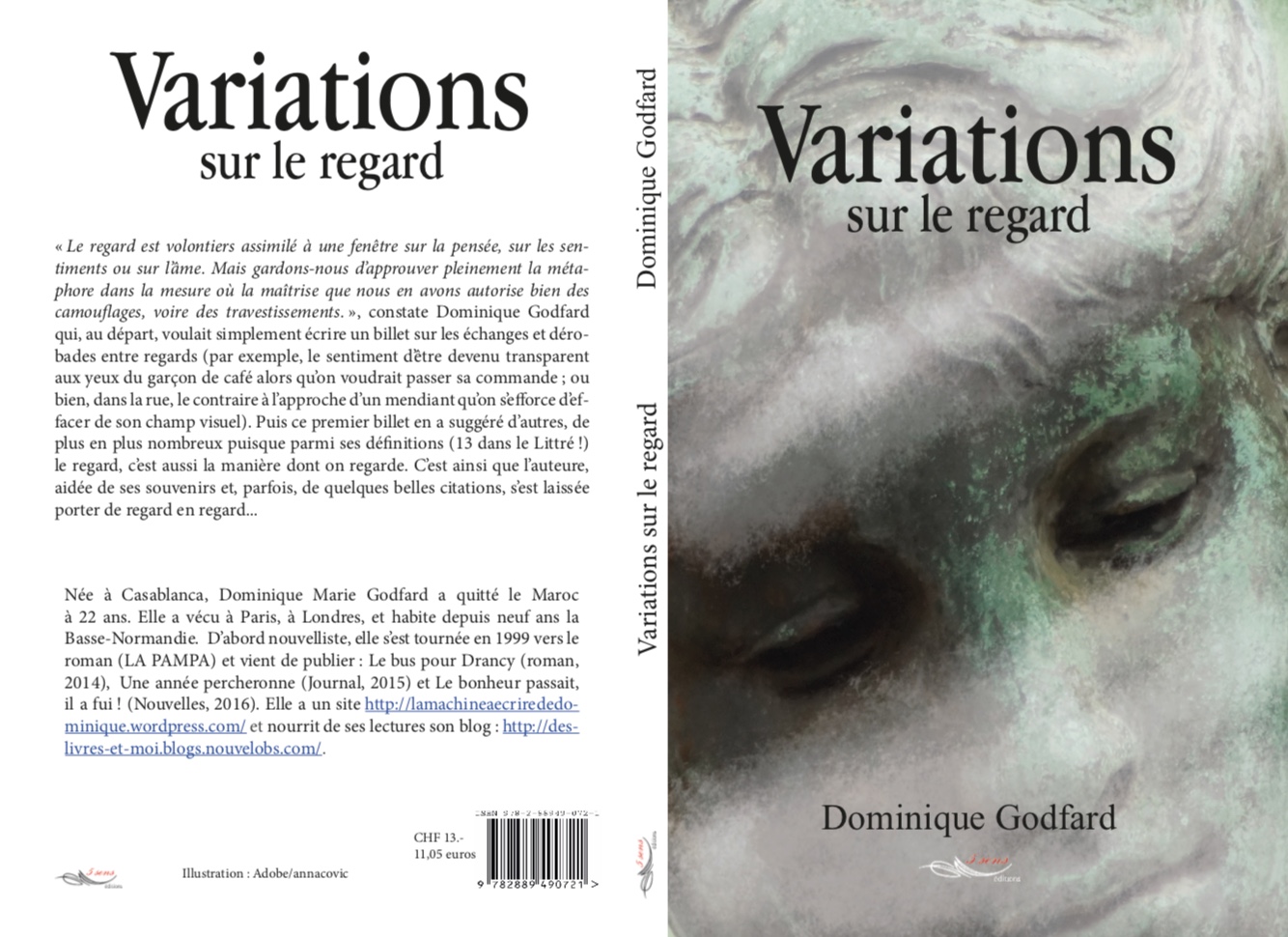Réflexe pavlovien ou corollaire d’un increvable espoir, je cours chaque matin à ma boîte aux lettres comme j’ouvrirais une pochette surprise alors que je connais son immuable contenu : factures et publicités. Très exceptionnellement, ce 9 avril 2023, ce fut l’aspect surprise qui l’emporta puisque je découvris un tas de brindilles jusqu’à mi-hauteur de l’habitacle… L’œuvre d’un animal, supputai-je avant de consulter ma voisine qui avança un mulot en raison de l’étroitesse d’une fente d’à peine deux centimètres de largeur. Réflexe pavlovien toujours, j’allai publier la photo du nid sur facebook : « A défaut de poulet dans ma boîte aux lettres, un nid de mulots… D’où la fable -assez méconnue, il est vrai- intitulée « Le poulet et les mulots » ! » J’avais intentionnellement employé le mot « poulet » dans le sens de « billet doux » afin de coller mes innombrables amis dont la plupart me sont totalement inconnus.
Le 17 avril, je réalisai que la « collée » c’était moi en découvrant un œuf dont je dus me résoudre à faire état ne serait-ce qu’au nom de l’honnêteté la plus élémentaire : « Nid dans ma boîte aux lettres (suite)… et mea-culpa puisque les mulots ne pondent pas ! Il me faudrait une boîte aux lettres bis et en avertir la factrice… Bref, je ne sais plus que faire ! »
Après avoir vertement tancé ma voisine pour la fausse piste du mulot, je résolus d’acheter une néo-boîte aux lettres avec ma cousine qui était de passage dans ma campagne. C’est ainsi que nous accrochâmes une grosse boîte en fer blanc sur le portail en la mettant bien évidence au bout d’une parcours fléché destiné à la factrice.
Comme je lus qu’il fallait éviter de déranger les hôtes de ma boîte aux lettres, je laissai passer une dizaine de jours avant de risquer un rapide coup d’œil qui me combla d’aise : nous avions sept œufs, ce qui ne manqua pas de me valoir des retours enthousiastes tels que : « ça frise l’élevage intensif ! » tandis qu’une amie de longue date, connaissant mes propensions à materner tout ce qui bouge, s’extasiait : « On pourrait dire ‘maman poule’ maintenant … C’est merveilleux. »
J’avais opté pour de très rares visites à mes futurs petits pensionnaires, prenant juste le temps d’une photo et repartant au triple galop. Hormis le risque de tomber bec-à-nez sur la mère ou le père, ces clichés de paparazzis avaient l’avantage de les déranger le moins longtemps possible tout en me permettant d’observer sur la photo les progrès à l’œuvre et, pour le moment, le nid dont j’admirais la forme arrondie comme la structure tapissée de duvet.
Après quelques recherches sur les durées de couvaison, je me fixai le 9 mai pour une nouvelle prise de vue rapide… Et là, miracle ! quatre minuscules becs jaunes grand ouverts au-dessus d’énormes ronds noirs plantés dans de petits corps rosâtres firent bondir mon cœur de joie : toute naissance est don du ciel, source d’un infini bonheur ! J’envoyai aussitôt la photo à ma cousine qui déclara avoir la larme à l’œil et s’écria : « Vive la vie ! » Sur facebook, on s’en réjouit fort. Parmi les nombreux commentaires, je notai « Tu es leur grand-mère quelque part ! », « Félicitations, Dominique, vous avez plein de petits-enfants… »
D’accord pour le costard grand-maternel, je l’endossai si bien qu’une dizaine de jours plus tard, le 18 mai, c’est une mamie au cœur serré par l’émotion qui entrouvrit la porte de la boîte aux lettres pour admirer, en vitesse, « ses » oisillons entassés les uns sur les autres. Ils avaient beaucoup grossi et pris l’aspect de « vrais » oiseaux avec têtes et ailes bien dessinées, couvertes de plumes foncées parfois barrées d’une raie jaune. Deux questions m’assaillirent aussitôt : quelle espèce de volatile ? Et surtout, comment allaient-ils sortir de la boîte aux lettres, si peu aguerris au décollage et sans doute incapables de se glisser par une fente ?… Devais-je laisser la porte entrouverte ? Cette dernière interrogation se fit taraudante car j’imaginais des chutes à la Icare sous le beau soleil printanier et, pire ! mes anges, ainsi que je les surnommais, livrés à de cruels crocs félins …
Par bonheur, quand j’eus le courage d’ouvrir la boîte aux lettres vers la Pentecôte, je la trouvai vide ! Quant à la réponse à ma question ornithologique, elle me vînt via Facebook : « Mésanges » …